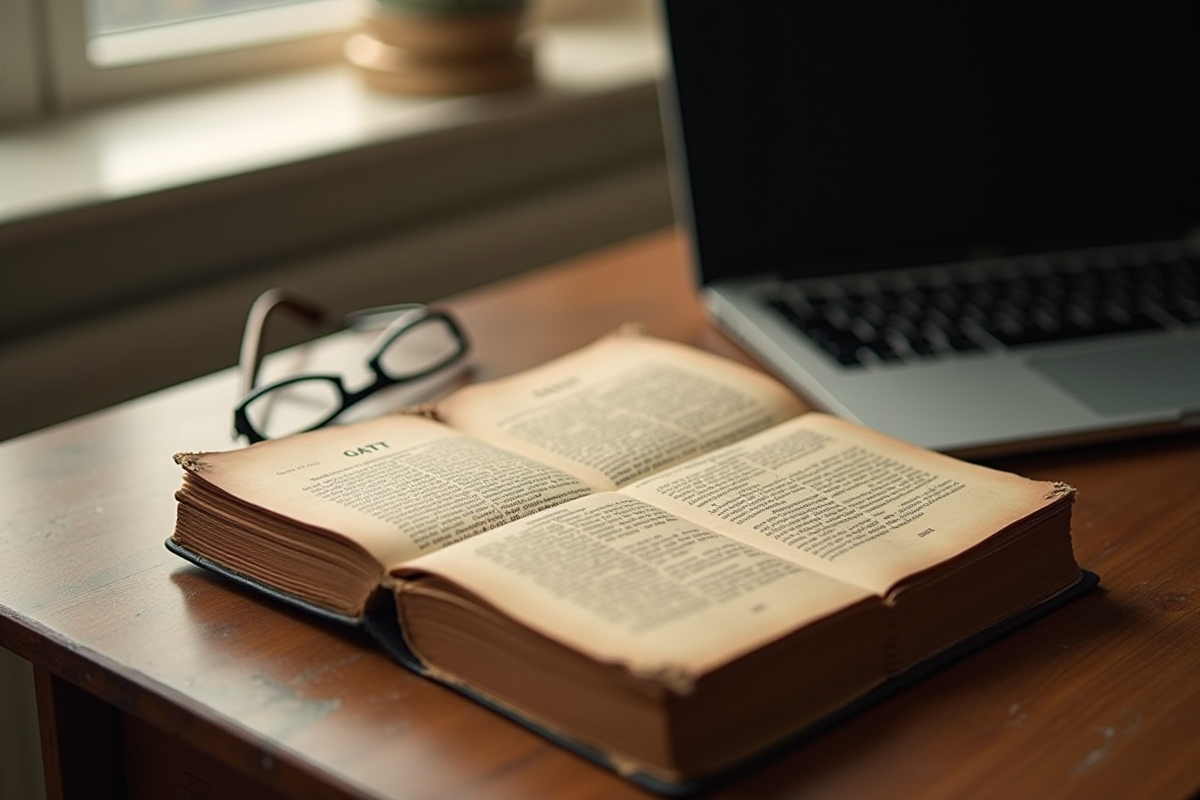Le texte du GATT de 1947 continue de s’appliquer à certains membres de l’Organisation mondiale du commerce, malgré la création de cette dernière en 1995 et l’entrée en vigueur de nouveaux accords. Plusieurs dispositions originales n’ont jamais été totalement remplacées ni abrogées.
Des exceptions subsistent dans la pratique commerciale internationale, notamment pour les économies les moins avancées ou lors de crises majeures. Certains différends devant l’OMC se règlent encore sur la base du corpus juridique du GATT, révélant la persistance de règles anciennes dans un système en constante mutation.
Le GATT, des origines à l’OMC : comprendre l’évolution d’un pilier du commerce mondial
L’histoire du GATT s’inscrit dans la reconstruction économique mondiale d’après-guerre. En 1947 à Genève, 23 pays décident d’ouvrir les frontières commerciales et de raboter les barrières douanières, poursuivant les ambitions esquissées par Roosevelt et Cordell Hull. Trois principes structurent l’édifice : la clause de la nation la plus favorisée, la réciprocité et la consolidation des concessions tarifaires. Huit rounds de négociation, de Genève à l’Uruguay, élargissent progressivement le périmètre des règles et les rangs des signataires, passant de 23 à 123 membres au seuil de 1995.
Il faut pourtant rappeler que le GATT n’a jamais été une organisation. Pendant des décennies, il laisse de côté des pans entiers du commerce mondial : agriculture, textiles, acier, aéronautique. Quand de nouveaux acteurs prennent leur essor, que les échanges de services montent en puissance, le cadre légal s’avère trop étroit. Les négociations du Uruguay Round (1986-1994) ouvrent alors une nouvelle ère. L’Accord de Marrakech pose les bases de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995, unifiant désormais sous une même bannière les règles et créant un mécanisme de règlement des différends contraignant.
Le moteur multilatéral, Etats-Unis, Union européenne, Japon en tête, tire les droits de douane moyens de 40 % à 4 % entre 1947 et 1997. Il façonne aussi des règles sur les services (AGCS), la propriété intellectuelle (ADPIC) et les investissements (TRIMS). Dirigeants comme Eric Wyndham White, Peter Sutherland, Renato Ruggiero impriment leur marque à cette architecture, dotant la nouvelle institution d’un agenda et d’une gouvernance. Aujourd’hui, 164 membres siègent à l’OMC, sous la présidence de Ngozi Okonjo-Iweala. Ce qui n’était qu’un traité est devenu une organisation tentaculaire, adaptée aux défis d’un commerce mondial démultiplié.
Quels défis pour le système commercial multilatéral aujourd’hui ?
Pendant des décennies, la libéralisation du commerce a guidé le GATT puis l’OMC, abaissant méthodiquement les obstacles tarifaires. Mais la dynamique s’est essoufflée. Depuis 2001, le Cycle de Doha piétine. Les fractures entre pays développés et pays en développement se creusent : les premiers veulent des avancées sur les services et la propriété intellectuelle, les seconds réclament souplesse et appui, surtout sur l’agriculture. La négociation s’enlise.
Le protectionnisme revient en force. Les États-Unis, longtemps fers de lance du multilatéralisme, préfèrent aujourd’hui la section 301 pour imposer des mesures unilatérales. L’Union européenne, la Chine ou le Canada multiplient les accords bilatéraux ou régionaux, s’éloignant du cadre collectif. Résultat : la cohérence du système s’effrite, et les différends commerciaux explosent. En 2021, l’OMC enregistre près de 600 litiges, un chiffre qui illustre une contestation toujours plus vive.
Le mécanisme de règlement des différends vacille à son tour. Les nominations à l’organe d’appel sont bloquées, fragilisant l’ensemble du dispositif. Les grands dossiers d’aujourd’hui, subventions publiques, transition écologique, souveraineté industrielle, échappent souvent au contrôle strict du multilatéralisme. Un système conçu pour la stabilité doit désormais composer avec la fragmentation, les rivalités géopolitiques et des agendas économiques de plus en plus hétérogènes.
Ressources et analyses pour approfondir l’étude du GATT et de l’OMC
Pour qui veut comprendre la mécanique et la portée du GATT et de l’OMC, quelques repères sont incontournables. L’accord de Genève de 1947, signé par 23 pays, sert d’ossature au système commercial international. Les différents rounds de négociation, du Tokyo Round sur les barrières non tarifaires au Kennedy Round et ses baisses tarifaires spectaculaires, jalonnent l’histoire du commerce mondial. L’aboutissement du Uruguay Round (1986-1994) donne naissance à l’OMC via l’Accord de Marrakech, signalant le passage d’un accord multilatéral à une véritable organisation internationale. Cette évolution accompagne de nouveaux enjeux : ouverture des services (AGCS), protection de la propriété intellectuelle (ADPIC), encadrement des investissements (TRIMS).
Pour se repérer dans cet univers, plusieurs outils sont à privilégier. Les textes fondateurs, Accord de Marrakech, actes finaux des rounds successifs, documents issus des Conférences ministérielles, fournissent la base documentaire. Les analyses institutionnelles de l’OMC, celles de la Banque mondiale ou du FMI, apportent des éclairages sur les dispositifs de règlement des différends et sur la géopolitique des négociations.
Voici quelques ressources clés à explorer pour aller plus loin :
- Les rapports annuels de l’OMC retracent l’évolution du commerce mondial et dressent l’état des règles en vigueur.
- Les archives du GATT permettent de remonter aux premiers pas du multilatéralisme commercial, jusqu’aux débats sur la création avortée de l’OIC à La Havane en 1948.
- Les biographies de figures majeures, de Peter Sutherland à Eric Wyndham White, dévoilent la dimension politique des grandes négociations.
L’examen du GATT et de l’OMC dépasse le simple récit institutionnel. Il croise le droit, l’économie internationale et les stratégies des États, des 23 pays fondateurs aux 164 membres actuels. S’interroger sur l’évolution des règles, le rôle des conférences ministérielles ou la trajectoire des accords sectoriels, c’est aussi saisir la mécanique d’un système qui, sans cesse, réinvente ses équilibres. Difficile de prédire la prochaine mutation, mais une chose est sûre : le commerce mondial ne cesse de surprendre ceux qui l’observent de près.